Tu es archiviste depuis des années et tu exerces ton métier avec passion, fierté et professionnalisme. Tu fais face chaque jour à de nombreux défis et prends des risques que beaucoup ne perçoivent pas forcément. Les risques du métier d’archiviste sont souvent méconnus pour ne pas dire sous-estimés.
Ce rôle central dans les entreprises et institutions expose les archivistes à des dangers physiques, psychosociaux et numériques. Entre manipulations de documents anciens, gestion de délais serrés et responsabilité de conservation, les professionnels font face à des menaces concrètes : troubles musculo-squelettiques, stress, allergies ou cyberattaques.
Ces menaces ne sont pas théoriques, elles affectent concrètement la santé et le bien-être des archivistes. Dans cet article, j’analyse en détail les dangers liés à ce métier, les bonnes pratiques à adopter et les solutions pour travailler sereinement tout en protégeant les archives.

Quels sont risques du métier d’archiviste ?
Risques physiques et maladies professionnelles chez les archivistes
Risques psychosociaux du métier d’archiviste : stress et isolement
Dangers numériques : archivage électronique et cybersécurité
Risques juridiques et déontologiques en archivistique
Risques du métier d’archiviste liés aux conflits hiérarchiques ou institutionnels
Prévention et bonnes pratiques pour limiter les risques du métier d’archiviste
Préserver la santé des archivistes et protéger les archives
Quels sont risques du métier d’archiviste
Archiver des documents peut sembler tranquille, mais chaque geste comporte ses dangers. Le métier d’archiviste, souvent perçu comme calme et méthodique, comporte en réalité de nombreux risques. À l’université, on nous apprend les missions de l’archiviste, les obligations de l’archiviste. Très peu de ressources abordent la question des droits des archivistes et des risques liés au métier d’archiviste.
Avant de penser à devenir archiviste ou de se spécialiser en archivage électronique, il est essentiel de connaître les risques du métier d’archiviste. Ils ne se limitent pas à la manipulation des documents. Ils concernent aussi la santé physique, le bien-être psychologique, la sécurité numérique, le respect des obligations légales et même la stabilité professionnelle.
Les connaître est indispensable pour mieux les anticiper et exercer ce métier en toute sérénité.
Risques physiques et maladies professionnelles chez les archivistes
Travailler dans les archives expose à des dangers physiques souvent sous-estimés. Les archivistes manipulent régulièrement des boîtes, cartons ou registres parfois très lourds. Ils le font généralement dans des locaux qui ne sont pas toujours adaptés ni suffisamment ventilés.
Cette exposition répétée des archivistes entraîne :
- des troubles musculo-squelettiques (TMS),
- des douleurs lombaires ou cervicales,
- ainsi que des blessures mineures liées aux manipulations répétées.
Mais ce n’est pas tout ! Les risques de chute et d’accident sont aussi présents. En effet, pour accéder aux étagères hautes, les archivistes utilisent régulièrement des escabeaux, montants roulants ou chariots élévateurs.
Une mauvaise stabilité, un sol glissant ou une surcharge peuvent provoquer des chutes parfois graves. De simples gestes, comme attraper une boîte trop lourde placée en hauteur, peuvent suffire à causer un accident. Les conditions de stockage mal adaptées aggravent encore ces dangers.
À cela s’ajoute l’exposition à des agents biologiques et chimiques. Les archives anciennes ou mal conservées peuvent contenir poussières, moisissures, psores et résidus de produits de traitement. Ces éléments sont responsables de nombreuses affections professionnelles :
- asthme,
- allergies respiratoires,
- irritations cutanées,
- voire fatigue chronique.
Le danger est encore plus marqué lorsqu’il s’agit de traiter un vrac archivistique. Ce sont souvent des fonds d’archives dégradés depuis plus d’un demi-siècle, parfois imprégnés d’humidité ou infestés de nuisibles.
Les chiffres confirment cette réalité. Selon plusieurs enquêtes menées par des universités et associations professionnelles, près de 40 à 50 % des archivistes déclarent souffrir de douleurs physiques liées à leur activité. Les maladies les plus fréquentes concernent les TMS, les infections respiratoires et les réactions allergiques.
Lire aussi : comment devenir un archiviste efficace et épanoui ?
Risques psychosociaux du métier d’archiviste : stress et isolement
Au-delà des dangers physiques, les risques psychosociaux du métier d’archiviste sont souvent négligés. Pression des délais, responsabilité de la conservation de documents précieux et isolement peuvent générer stress, fatigue et anxiété. Ces facteurs impactent non seulement la santé mentale, mais aussi la concentration et la qualité de vie et du travail des archivistes.
La surcharge de tâches, souvent liée au manque de moyens humains et financiers, conduit certains archivistes à un épuisement professionnel voire à un burn-out. La peur d’endommager des documents uniques ou confidentiels accentue encore le stress, créant un environnement de travail émotionnellement exigeant.
Plusieurs études mettent en évidence que ces contraintes ont un impact mesurable sur la productivité et à terme, sur la sécurité même des fonds documentaires. L’isolement constitue un autre facteur aggravant. De nombreux archivistes travaillent seuls, parfois dans des locaux peu fréquentés, ce qui accentue le sentiment d’exclusion et le manque de reconnaissance.
À ces pressions s’ajoute un autre aspect souvent passé sous silence : la reconnaissance du métier. L’archiviste doit fréquemment faire face à des remarques dévalorisantes du type : « tu ne fais que classer des documents ». Ces jugements réducteurs minimisent la complexité et la technicité du métier.
Ils renforcent le sentiment d’isolement et l’obligation constante de prouver sa valeur au sein de l’organisation. Ce contexte professionnel peut aussi engendrer anxiété et démotivation. Cette lutte pour la reconnaissance peut parfois être plus difficile à gérer que la manipulation de charges lourdes.
Travailler avec des moyens limités, sous le regard d’une hiérarchie peu sensibilisée à l’importance des archives, impose un stress supplémentaire.
Lire aussi : 6 erreurs à éviter en tant qu’archiviste
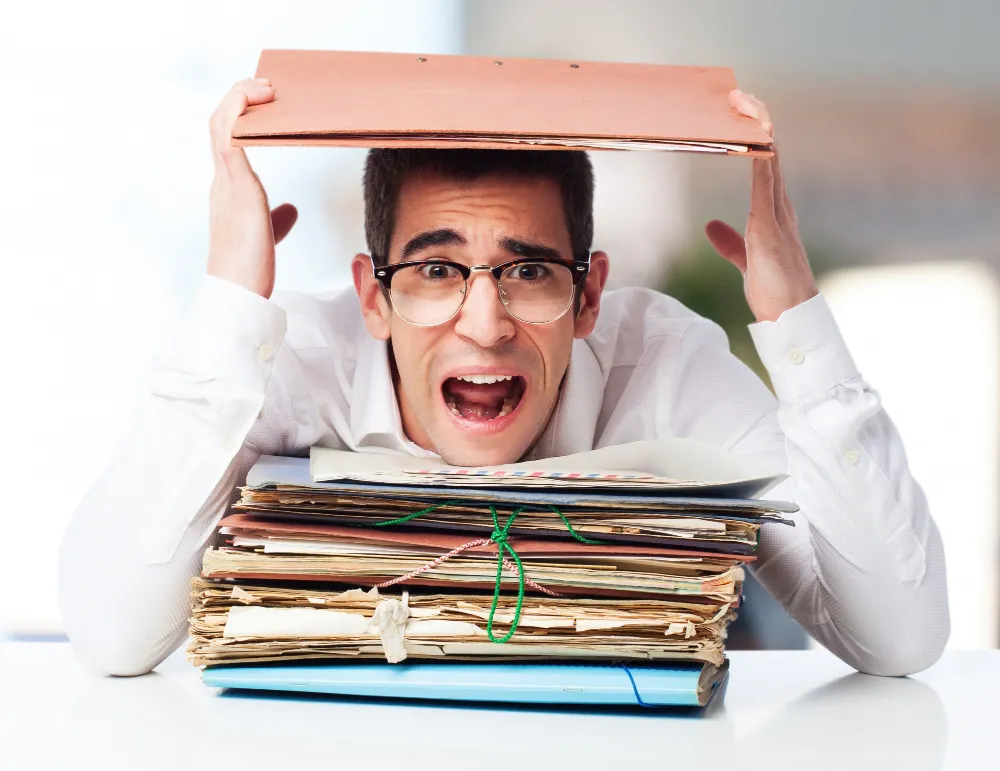
Dangers numériques : archivage électronique et cybersécurité
L’évolution numérique a profondément transformé la gestion documentaire, offrant de nouvelles opportunités d’accessibilité, de partage et de valorisation des archives. Mais cette modernisation s’accompagne aussi de risques spécifiques à l’archivage électronique, souvent moins visibles que les dangers physiques, mais tout aussi critiques.
La perte de données, les erreurs de manipulation ou encore les cyberattaques constituent des menaces majeures. Un fichier mal classé, une absence de sauvegardes régulières ou une mauvaise gouvernance documentaire peuvent entraîner la disparition définitive d’archives essentielles.
Dans certains cas, ces incidents compromettent la mémoire institutionnelle et la continuité des activités. Ils exposent les organisations à des conséquences juridiques, financières et réputationnelles.
L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les pratiques documentaires soulève également des inquiétudes. Certains acteurs, comme Microsoft, ont déjà évoqué la possibilité que l’IA prenne en charge une partie des tâches traditionnellement confiées aux archivistes. À chaque révolution technologique, on annonce la « fin du métier ».
Pourtant, l’expérience montre que si les outils évoluent, le rôle de l’archiviste reste essentiel pour garantir :
- la fiabilité,
- l’authenticité,
- et l’éthique dans la gestion des archives numériques.
L’archiviste doit désormais maîtriser la cybersécurité, la gouvernance de l’information et la préservation numérique. Le risque ne réside pas tant dans l’IA elle-même que dans une mauvaise anticipation de ces changements. Ceux qui s’adaptent et développent de nouvelles expertises renforcent la légitimité du métier face aux défis numériques.
Risques juridiques et déontologiques en archivistique
Le métier d’archiviste ne se limite pas à manipuler des boîtes et classer des dossiers. Il s’accompagne aussi d’une responsabilité juridique et éthique importante. En effet, une mauvaise gestion des documents sensibles peut avoir des conséquences lourdes, non seulement pour l’organisation, mais aussi pour l’archiviste lui-même.
Les erreurs les plus critiques concernent :
- la violation du secret professionnel,
- la perte ou la destruction de documents légaux,
- ainsi que le non-respect des réglementations en vigueur, comme le RGPD pour les données personnelles.
Ces fautes peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, financières et parfois même des poursuites pénales. Un archiviste peut, dans certains cas, se retrouver confronté à la justice et risquer la prison s’il est reconnu coupable de négligence grave ou de destruction volontaire.
À cela s’ajoute une dimension déontologique : respecter l’intégrité des archives et garantir leur authenticité est une mission centrale. Chaque décision prise engage la responsabilité professionnelle de l’archiviste. Une vigilance constante et une parfaite connaissance du cadre légal sont donc essentielles pour exercer ce métier en toute sécurité.
Risques du métier d’archiviste liés aux conflits hiérarchiques ou institutionnels
Le métier d’archiviste n’est pas seulement technique, il est aussi profondément politique. Dans certaines situations, l’archiviste peut se retrouver pris entre plusieurs forces contradictoires :
- hiérarchie,
- institutions publiques,
- pressions politiques,
- ou encore attentes de la société civile.
Ces conflits créent des risques éthiques et professionnels. Un archiviste peut, par exemple, recevoir l’ordre de détruire ou de cacher certains documents sensibles, alors même que la loi impose leur conservation. Céder à ces pressions signifie violer les règles déontologiques et courir le risque de sanctions juridiques. Résister, en revanche, peut entraîner des représailles hiérarchiques, une mise à l’écart professionnelle, voire la perte de son poste. C’est un dilemme lourd à porter.
L’exemple de Colleen Shogan, archiviste des États-Unis, illustre bien ce danger. Nommée en 2023, elle a rapidement été confrontée à une forte polarisation politique. Le rôle des National Archives, notamment dans la gestion des documents sensibles liés à l’ancien président Donald Trump, l’a placée au centre de polémiques.
Accusée par certains camps de partialité et pressée par d’autres de protéger l’intégrité des archives, elle incarne parfaitement la pression que peut subir un archiviste de haut niveau. Son cas rappelle que même au sommet, un archiviste peut devenir une cible dans des luttes de pouvoir.
Ces situations montrent que le risque institutionnel dépasse le cadre technique. Il engage directement la liberté, la réputation et la carrière de l’archiviste. La seule protection réside dans une solide connaissance du droit, une éthique professionnelle inébranlable et, parfois, le courage de dire non.
Prévention et bonnes pratiques pour limiter les risques du métier d’archiviste
Prévenir les risques du métier d’archiviste n’est pas seulement une obligation légale. C’est une nécessité vitale pour protéger la santé des professionnels, assurer la continuité du service et garantir la préservation du patrimoine documentaire. Chaque type de risque appelle des mesures adaptées, à la fois individuelles et collectives.
Prévenir les risques physiques et environnementaux
La prévention des risques physiques chez les archivistes passe avant tout par une organisation rigoureuse et des équipements adaptés. Pour limiter les troubles musculo-squelettiques, il est essentiel de former les archivistes aux bonnes postures :
- plier les genoux plutôt que le dos,
- éviter les torsions brusques,
- ne pas porter de charges trop lourdes seul.
Des chariots solides, des escabeaux stables et des rayonnages à hauteur ajustée réduisent considérablement les risques de chute. L’environnement de travail doit aussi être sécurisé : sols antidérapants, bonne ventilation, éclairage suffisant et contrôle régulier de la stabilité des installations.
Pour se protéger des moisissures et poussières, des masques et gants adaptés sont indispensables, tout comme un entretien régulier des dépôts. Enfin, mettre en place des protocoles de sécurité incendie et de gestion des accidents garantit une réactivité immédiate en cas d’urgence.
Ces mesures simples, mais essentielles protègent la santé des archivistes et assurent la pérennité des archives.
Lire aussi : Plan de mesures d’urgence et de sauvetage des archives : pourquoi et comment en élaborer ?
Prévenir les risques psychosociaux et le burn-out
La lutte contre les risques psychosociaux repose sur une meilleure organisation du travail et un soutien constant des archivistes. Pour réduire la surcharge mentale, il est conseillé d’instaurer des rotations de tâches, permettant d’alterner entre activités physiques, intellectuelles et numériques. Des pauses régulières aident aussi à diminuer la fatigue et à maintenir la concentration.
La reconnaissance professionnelle est un facteur clé. Valoriser le rôle des archivistes par des formations, des évaluations positives et une meilleure intégration dans les projets renforce leur motivation. Un environnement de travail collaboratif, basé sur le partage et la communication, réduit l’isolement.
Les services de soutien psychologique, comme une cellule d’écoute, doivent être accessibles en cas de besoin. Enfin, la sensibilisation des responsables hiérarchiques à la gestion du stress contribue à instaurer une culture organisationnelle plus bienveillante. Prévenir les risques psychosociaux permet d’améliorer à la fois la santé mentale et la productivité.
Anticiper les risques numériques et technologiques liés à la cybersécurité
L’archivage numérique comporte de nombreux dangers : perte de données, cyberattaques, erreurs de manipulation. Pour les prévenir, la mise en place de sauvegardes régulières est indispensable. Les documents doivent être copiés sur plusieurs supports sécurisés : serveurs externes, solutions cloud fiables et disques durs chiffrés.
La cybersécurité doit être renforcée par des antivirus à jour, des pare-feu performants et des mots de passe robustes régulièrement renouvelés. Former les archivistes à reconnaître les tentatives de phishing ou de piratage constitue aussi une mesure efficace.
Une gouvernance claire des données numériques, avec des procédures précises de classement et de gestion des accès, réduit les risques d’erreur. Enfin, la sensibilisation à la longévité des formats numériques permet d’éviter l’obsolescence technologique. La prévention des risques liés à l’archivage électronique assure la sécurité des données et protège l’intégrité des archives dans le temps.
Lire aussi : comment rédiger un plan de gestion des risques informationnels : guide complet
Prévenir les risques juridiques et déontologiques
La prévention des risques juridiques dans le métier d’archiviste repose sur la connaissance et l’application rigoureuse des lois. Chaque archiviste doit être formé aux réglementations en vigueur :
- législation sur les archives publiques,
- règles de conservation,
- délais légaux de destruction, mais aussi protection des données personnelles comme le RGPD.
Pour limiter les erreurs, des protocoles clairs et documentés doivent encadrer la gestion des archives sensibles. Chaque action (classement, transfert, destruction) doit être tracée et validée. Cette traçabilité protège l’archiviste en cas de litige.
Des chartes déontologiques peuvent servir de guide en cas de dilemme éthique, notamment lorsque la hiérarchie exerce des pressions. Enfin, souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle offre une protection supplémentaire.
Ces mesures permettent de prévenir les risques de sanctions financières, disciplinaires ou même pénales, et garantissent que l’archiviste exerce ses missions en toute sérénité et légalité.
Prévenir les conflits institutionnels et hiérarchiques
Les conflits institutionnels sont parmi les risques les plus délicats à gérer pour un archiviste. Pour les anticiper, il est essentiel de promouvoir la transparence et la documentation des décisions. Chaque instruction ou ordre reçu doit être consigné, afin de protéger l’archiviste en cas de contestation future.
La mise en place de chartes déontologiques reconnues par l’institution permet de rappeler les limites de la profession et de protéger les archivistes contre des demandes abusives, comme la dissimulation ou la destruction illégale de documents. Des instances de médiation interne, ou le recours à des syndicats ou associations professionnelles peuvent également servir de soutien.
Enfin, une formation régulière en éthique professionnelle renforce la capacité des archivistes à résister aux pressions. Ces mesures de prévention réduisent les risques de sanctions hiérarchiques ou judiciaires. Elles garantissent que l’archiviste puisse défendre son intégrité tout en protégeant le patrimoine documentaire.
Préserver la santé des archivistes et protéger les archives
Les risques du métier d’archiviste ne doivent jamais être sous-estimés. Entre troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, maladies professionnelles et dangers liés à l’archivage numérique, le rôle d’archiviste exige vigilance, préparation et prévention.
Comprendre ces dangers du métier d’archiviste est la première étape pour protéger sa santé et celle des collègues. Appliquer les bonnes pratiques ergonomiques, respecter les normes de sécurité archivistes, limiter l’exposition aux moisissures et poussières, et organiser correctement les archives permet de réduire les incidents. La formation continue et la sensibilisation aux risques professionnels dans les archives sont également essentielles.
Prévenir les accidents et maladies professionnelles n’est pas seulement une obligation. C’est un investissement pour la sérénité des archivistes et la gestion durable des documents précieux. Imaginez un environnement de travail où chaque archiviste peut exercer son métier sereinement, en toute sécurité, tout en garantissant l’intégrité des archives. C’est exactement ce que permet une gestion proactive des risques.
FAQ sur les risques du métier d’archiviste
Les archivistes sont exposés à des risques physiques (TMS, allergies), psychosociaux (stress, isolement), numériques (perte de données, cyberattaques), juridiques (RGPD, secret professionnel) et institutionnels (pressions hiérarchiques).
Les plus fréquentes sont les troubles musculo-squelettiques, les allergies respiratoires et les irritations cutanées liées aux poussières et moisissures.
En adoptant de bonnes postures, en utilisant des équipements adaptés (chariots, escabeaux stables) et en portant gants et masques dans les dépôts.
Il comporte des risques, mais ceux-ci peuvent être réduits grâce à la prévention, à la formation et à des conditions de travail adaptées.